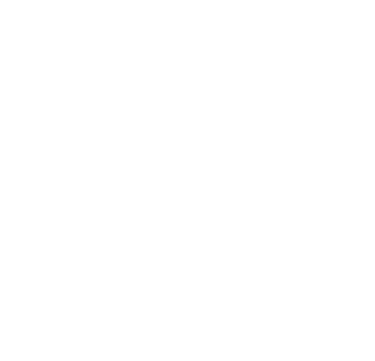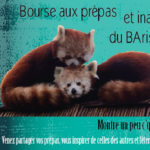Ce matin à Nantes1 , Anne Herla et Aurore Compère ont proposé une intervention dans le chantier PhiloFormation, autour de la formation à la neutralité des futur·e·s enseignant·e·s et des exercices qu’elles proposent aux étudiant·e·s du Master en philosophie à finalité didactique en philosophie et citoyenneté.
Pour les participant·e·s, voici les slides et les situations délicates proposées dans le second exercice :
Situations délicates
Cours sur le relativisme (UAA 311).
Il fait radieux, les élèves sont gênées par les rayons qui leur viennent dans les yeux
La prof : – Un relativiste épistémologique radical dirait que cellui qui dit qu’aujourd’hui il y a du soleil et cellui qui dit qu’aujourd’hui il pleut ont tous les deux également raison. Vous voyez ? Il n’y a pas de référent extérieur, tous les discours se valent.
L’élève la plus gênée par le soleil : – Mais c’est pas vrai, Madame, il y a du soleil, on voit bien.
La prof : – Oui, mais pour le relativiste, radical, hein, quelqu’un de vraiment très relativiste, ce qui compte ça n’est pas le réel, tout se vaut parce que chacun·e a son point de vue, « sa réalité ».
Une autre élève : – Ah oui, c’est comme les gens qui disent qu’ils se sentent fille…
Cours sur les moyens de connaître (UAA 311).
La prof : – Ok, item suivant, est-ce qu’on peut savoir que nous et les singes on est cousins juste via l’observation ?
Une élève : – Ben, oui, ils nous ressemblent vachement.
Une autre : – Ben non ils ne nous ressemblent pas.
Une troisième : – Et on n’est pas les cousins des singes, mes cousins c’est pas des singes.
La prof : – Pas « cousins » au sens où ils auraient les mêmes grands-parents que toi pour-de-vrai, hein, des cousins très éloignés, mais qui ont un ancêtre commun, un ancêtre qui vivait il y a plusieurs millions d’années et dont la descendance a donné des lignées phylogénétiques distinctes mais proches.
La première élève : – On se ressemble, non, ça suffit à savoir qu’on est proches.
La prof : – C’est vrai que certains singes ont des noms qui indiquent qu’à la ressemblance seule on se doutait déjà un peu qu’il y avait quelque chose, comme l’Orang Outan, dont le nom veut dire « l’homme de la forêt ». Et les scientifiques qui ont émis cette théorie n’avaient pas beaucoup d’autres moyens à leur disposition que l’observation, mais quand même, ils ne se sont pas contentés de les voir, ils ont pu en disséquer, pour comparer le squelette, la musculature…
La seconde élève : – C’est pas parce qu’on se ressemble qu’on est cousins.
La prof : – Mais maintenant on a des certitudes plus arrêtées, parce qu’on a l’ADN, et qu’on a pu décoder les génomes, et les comparer, et voir que certains gènes sont communs…
La troisième : – Ça veut rien dire.
La première : – Donc c’est pas par observation, c’est par expérimentation, comme pour savoir qu’il faut un ovule et un spermatozoïde pour faire un bébé, c’est ça ?
La seconde : – On n’est pas obligé de croire à tout ça, moi je n’y crois pas.
Cours sur les méthodologies médicales (UAA 312).
Le prof : – Vous vous souvenez, donc, la semaine dernière, on parlait de la première étude médicale contre placebo, qui visait à savoir si Mesmer et des disciples disaient vrai quand ils prétendaient pouvoir soigner les gens en manipulant leur « champ magnétique », sur base d’une théorie qui disait qu’il existait un « magnétisme animal » ?
Une élève : – Mais alors Monsieur c’est les animaux qu’ils soignaient ?
Le prof : – Non, non, enfin peut-être qu’ils soignaient les animaux aussi, mais ici l’étude contre placebo en question, c’est une étude clinique, vous vous souvenez, donc sur des vrais patients, des patients humains. C’est parce que tout le monde à Paris allait se faire magnétiser que le Roi de France de l’époque a dépêché une commission scientifique pour faire cette étude.
Une autre élève : – Mais alors pourquoi vous dites que c’est pour des animaux ?
Le prof : – Je ne dis pas que c’est pour des animaux, leur théorie c’est qu’il existe un « magnétisme animal », qui serait un peu comme le magnétisme tout court, celui des aimants, tu vois, les aimants ils ont un champ magnétique, qu’on représente avec des lignes comme ça (il dessine au tableau), et eux ils disaient que les animaux, donc les humains aussi, avaient un champ magnétique (il dessine un humain avec un champ magnétique au tableau) autour d’eux et qu’on pouvait le manipuler, à distance, pour les soigner.
La première élève : – Mais les animaux ils l’ont peut-être et pas les humains.
Le prof : – Ben non, puisque l’humain c’est un animal, ils parlaient de magnétisme animal pour dire que les humains l’avaient aussi.
La seconde élève : – Vous êtes un animal si vous voulez, mais moi je suis un humain.
Cours sur la signification du mot « démocratie » (UAA 315).
La prof : – Bon, maintenant qu’on sait que « Démocratie » ça veut dire « le peuple, et le pouvoir », donc « le peuple a le pouvoir », quels problèmes ça pose, immédiatement, cette idée que c’est le peuple qui a le pouvoir ? Vous qui vivez en démocratie, et qui êtes le peuple qui a le pouvoir, qu’est-ce que vous y voyez comme « petit caillou dans la chaussure », comme problème ?
Un élève : – Ben y’en a qui abusent.
La prof : – Qui abusent de quoi ? De leur pouvoir politique ?
L’élève : – De leur pouvoir, pas vraiment, mais qui parlent trop.
La prof : – Qui parlent trop ? Tu pourrais clarifier ?
L’élève : – Ben ils font genre ils peuvent parler, ils ont la liberté, et ils abusent, ils cherchent.
La prof : – Ah ok, parce qu’ils sont en démocratie ils ont une grande liberté d’expression, c’est ça ? (L’élève acquiesce) Et du coup ils abusent de cette liberté ? Il cherchent quoi ?
L’élève : – Chais pas, ils cherchent, quoi, ils disent des trucs, ou ils font des dessins, des trucs…
Cours sur l’origine des États (UAA 316).
La prof : – Jusqu’ici on a questionné les fondements des États : on s’est interrogées sur les raisons qui justifient ce régime politique. On va maintenant s’intéresser à l’origine des États, à la question de leur genèse, de leur avènement, donc plutôt d’un point de vue historique, ou socio-historique, parce qu’il n’y a pas toujours eu des États, et même quand il y en avait il n’y en avait pas partout. Est-ce que vous vous souvenez, de vos cours d’Histoire, où sont nés les premiers États ?
La classe : – …
La prof : – Non ? Personne ? Vous n’avez pas vu ça en Histoire ? Moi j’étudiais ça au début du secondaire, en première : la Mésopotamie
La classe : – …
La prof : – Ok, bon, donc on trouve les plus anciennes traces d’États, les documents comme les ruines de greniers à grain, casernes militaires, sur la zone qu’on appelle Mésopotamie, et qui correspond à l’Irak et à la Syrie actuels. On a aussi de très anciens États en Chine, un peu plus tardifs. Ces traces datent de la fin du néolithique, vous voyez quand c’est le néolithique ?
La classe : – …
La prof : – C’est la période historique qui voit l’avènement de l’écriture, elle va de -10 000 à -2 000, et l’écriture, comme vous l’avez vu en Histoire en début d’année, naît vers -3 500, dans ces premiers États justement, pour formaliser les lois, administrer les impôts et gérer les stocks semble-t-il. Mais avant les premiers États, avant -4 000, il y a eu une très, très longue période, puisque les premiers hominidés sont apparus sur Terre il y a entre 2,8 et 2,4 millions …
Une élève, la coupant : – Ah non, hein, vous n’allez pas nous parler des hommes de Cro-Magnon, hein ? C’est bon, les premiers humains, c’est Adam et Ève, tout le monde sait ça !
Cours sur la différence sexe-genre-sexualité (UAA 213).
Le prof : – Maintenant que la différence entre sexe et genre semble acquise, on en vient à la troisième signification du mot « sexe » qu’on a isolée : celle qui concerne la sexualité, les relations sexuelles. On va s’intéresser à deux grandes dimensions de la sexualité, l’ « orientation sexuelle », et les « pratiques sexuelles ». Tout le monde voit ce que c’est l’orientation sexuelle d’une personne ?
Une élève : –
C’est être homosexuel ?
Le prof : – Oui, notamment, vous connaissez d’autres orientations sexuelles ?
Une autre élève : – Bi ?
Le prof : – Par exemple, oui, ou hétérosexuel·le, ou encore pansexuel·le, ou asexuel·le… Donc l’orientation sexuelle c’est par quelles personnes on est attiré·e sexuellement, vers quelles catégories de personnes, en termes de sexe et/ou de genre, notre désir sexuelle s’oriente.
La première élève : – Moi, c’est OK, les gens ils font ce qu’ils veulent chez eux, mais qu’ils ne viennent pas se tenir la main ou s’embrasser dans la rue !
Entame d’un cours, premier cours de l’année.
La prof (après avoir fait le tour des prénoms) : – Bonjour à tous, vous étiez tous déjà dans cette école l’année passée ?
Les élèves opinent du chef.
La prof : – Pas un seul nouveau ? Waw. Donc l’année passée vous avez eu cours de Philosophie et citoyenneté avec Monsieur X ?
Les élèves répondent en vrac. On entend un « oui », un « cours, cours, on n’a pas fait grand chose », et un « on faisait rien »
La prof : – Vous n’avez pas rien fait, la classe précédente, de 5ème aussi, l’année passée avec lui ils ont étudié les procédés rhétoriques de manipulation. Pas vous ?
Un élève : – Si, si, je me souviens, la manipulation, si.
Un autre élève : – T’façon, ce prof, il est gay.
Cours sur la justice (UAA 325).
La prof : – Autour de la Justice, dites-moi tous les mots qui vous viennent autour de la justice.
Les élèves écrivent plein de mots (loi, « donner raison à quelqu’un », amendes, police, prison…) et à un moment « vengeance » apparaît à l’écran. Après avoir traité quelques autres mots, elle demande : « qui a dit Vengeance ? »
L’élève : – C’est moi, moi j’trouve que c’est bien de pouvoir se venger.
La prof : – Ah oui, tu trouves que c’est une bonne chose ?
L’élève : – Oui ! C’est ça qu’il faut faire, il faut pouvoir se faire justice soi-même.
- aux Rencontres Internationales sur les Nouvelles Pratiques Philosophiques, qui se déroulent ces 19 et 20 novembre à l’université de Nantes sur le thème de « l’engagement » [↩]