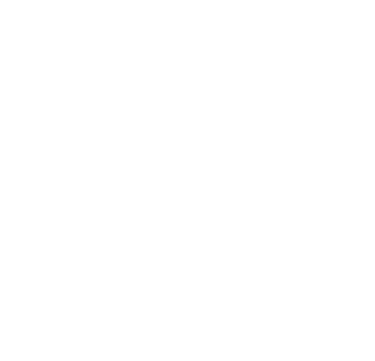Sorti en octobre 2024, Le Grand Test est un roman pour ados écrit par Josepha Calcerano et publié par les éditions le Muscadier dans la collection « Rester Vivant ». Les ouvrages de cette collection ciblent différents enjeux théoriques et pratiques auxquels peuvent être confronté·es les jeunes, depuis l’amour et l’amitié jusqu’au numérique, en passant par des questionnements plus larges, écologiques, sociaux ou éthiques. Puisqu’il s’agit d’un roman, je propose d’abord de nous plonger dans celui-ci et de voyager avec lui, pour ensuite essayer de comprendre ce qu’il permet de faire lorsque nous le lisons ou le faisons lire.
Avec Le Grand Test, Josepha Calcerano propose un ouvrage à caractère philosophique qui aborde des questionnements moraux et politiques. L’autrice nous dépeint la « Société Nouvelle », une société fictive composée uniquement de citoyen·nes ayant pu démontrer un indice de moralité jugé suffisant. Quiconque n’atteint pas un indice suffisant sera éjecté·e de la Société et banni·e dans le « No Man’s Land » des « Asociaux ». Ainsi, durant l’année de ses 16 ans, chaque membre de la Société Nouvelle doit quitter sa famille pour aller passer ce « Grand Test » de moralité. Une semaine durant, chaque jeune passe des épreuves et voit son indice de moralité fluctuer au gré de ses décisions. La Société Nouvelle se prétend moralement bonne et nous sommes les seuls responsables de nos actions, et de nos échecs.
C’est dans ce contexte que le roman nous fait suivre le point de vue de Tara Conway et d’autres jeunes qui deviendront pour certain·es de véritables ami·es et compagnon·nes d’aventure : Tess, Ryan et Renzo. Jour après jour, Tara est confrontée à différents dilemmes moraux. Face à ces dilemmes, les lecteurs et lectrices pourront reconnaître dans les réactions des jeunes l’une ou l’autre position morale (déontologisme kantien, conséquentialisme, utilitarisme, etc.). C’est une autre difficulté que doivent surmonter ces jeunes : comment prendre une décision s’il y a une diversité de positions morales ? Comment les concilier ? Au fil de l’aventure, cependant, quelque chose commence à clocher : les jeunes n’ont pas toujours l’impression de comprendre où ces épreuves veulent en venir. Pire, certaines épreuves leur donnent justement le sentiment de ne pas agir moralement s’ils respectaient ce qu’ils pensent qu’on leur demande. Mécompréhension ou simulacre de bien moral ? Telle est la question. En effet, comment savoir si l’on a bien agi lorsque l’on nous demande de torturer voire de tuer un individu dit « asocial » afin d’espérer préserver la Société Nouvelle d’une attaque à son encontre ?
En parallèle de ces épreuves, lorsque Tara réfléchit à ce qu’elle vient de vivre ou de faire, elle remarque tout un tas de graffitis et de mots gravés sur les murs. Pouvant être pris comme les traces d’un passé révolu (pré-Société Nouvelle) ou de précédents passages du Grand Test, ces inscriptions reviennent de plus en plus régulièrement au fil des pages. Y a-t-il de plus en plus de marques ou Tara s’y rend-elle plus alerte au fil de l’aventure ? Je vous laisse le découvrir. Ce qu’il faut en revanche comprendre, c’est que ces épreuves morales fragilisent Tara, son identité (morale) et son existence entière. Ces graffitis servent alors de points d’attention voire de miroirs cathartiques qui permettent de creuser plus profondément encore cette fragilité, ou au contraire de l’aider à se ressaisir et à décider pour elle-même.
Ces graffitis semblent jouer un rôle important pour Tara. Ils l’émancipent du test qui a mis son existence en péril et lui permettent de le questionner. Les graffitis sont porteurs d’une histoire et d’une pensée qui permettent d’enrichir celles de nos personnages et des lecteurs et lectrices. C’est ce que Josepha Calcerano montre par ailleurs en faisant figurer au fil de l’ouvrage quelques photographies de lieux tagués dont proviennent justement les différentes expressions caractéristiques qu’elle mobilise, dont une en particulier qui a retenu mon attention comme celle de Tara, représentée à la page 86 : « pense différemment ».
En d’autres termes, le roman semble servir un double-enjeu : d’une part visibiliser une pensée urbaine, son émergence et ses effets, d’autre part servir d’occasion à penser différemment. Mais, qu’est-ce que cela veut dire que « penser différemment » ? Par rapport à quoi faut-il penser différemment ? Comment faire ?
Le Grand Test n’est pas un ouvrage de vulgarisation. Si l’on peut reconnaître telle ou telle position morale ou philosophique chez tel ou tel personnage, le roman ne prend ni le temps de les développer ni de les questionner. Cela ne me semble d’ailleurs pas être le but. Nous avons en face de nous des ados, pressés par le temps et par les épreuves que lui impose cette Société, qui n’ont que faire de toutes ces théories. Plutôt que de penser les ados comme des vases à remplir par nos règles, théories et autres principes, l’ouvrage de Josepha Calcerano et ces murs tagués et photographiés les font exister. Ce que cela indique et fait exister est tantôt une fracture identitaire de l’individu, tantôt une fracture morale, ou encore tout ce qui nous pousse à laisser des traces, à essayer de dire quelque chose, et surtout, à essayer de vivre, du moins d’en avoir la possibilité. En bref, cet ouvrage permet de faire exister des moments de questionnement. Penser différemment, c’est alors simplement s’ouvrir à ce moment et à ce questionnement, à la possibilité de questionner tout ce que l’on nous raconte et ce qui nous fragilise. Le Grand Test raconte ce moment tel qu’il est vécu par Tara. En cela, sa lecture accompagne le voyage des adolescent·es en quête d’eux-mêmes que l’ouvrage vise – si tant est que cette quête puisse s’achever un jour. Au fond, ce roman nous est peut-être destiné à tou·tes.
Cependant, si l’on peut revivre cette expérience grâce à Tara et ses aventures, et si l’on peut également se prêter au jeu des dilemmes imposés à Tara et ses ami·es et se demander comment l’on aurait agi, il demeure que pousser à penser différemment et permettre de le faire sont deux choses différentes. Comment faire penser, et plus encore différemment ?
Tout comme l’ouvrage est cerné par des photographies qui l’enveloppent et l’accompagnent, lui permettant de faire ce lien vers une pensée urbaine, sa lecture pourrait en effet être appuyée par des réflexions supplémentaires, en amont et en aval, sur les théories morales, leurs buts et leurs conséquences. On pourrait également poursuivre l’histoire de Tara et ses ami·es afin de continuer notre réflexion et de la rendre concrète : comment penser la « contre-société » de cet ordre moral instauré par la Société Nouvelle que rejoignent Tara et ses pairs ? Ce serait alors l’occasion de donner du corps à ce « penser différemment » qui reste pour l’heure un idéal, l’écho d’existences fragilisées espérant une vie autre.
En d’autres termes, la seule lecture de l’ouvrage ne suffit pas à concrétiser ce projet. Alors que le graffiti induit des réflexions aux personnages du roman, la lecture du roman incite à penser différemment. Pour donner corps à cette idée, il semble qu’il soit également nécessaire d’accompagner les lecteurs et lectrices en leur fournissant divers outils qui permettent de penser différemment, et par conséquent de repenser nos propres postures morales et celles de nos sociétés. Ce sont ces outils qui restent à penser, avec et pour tous ces jeunes à venir.